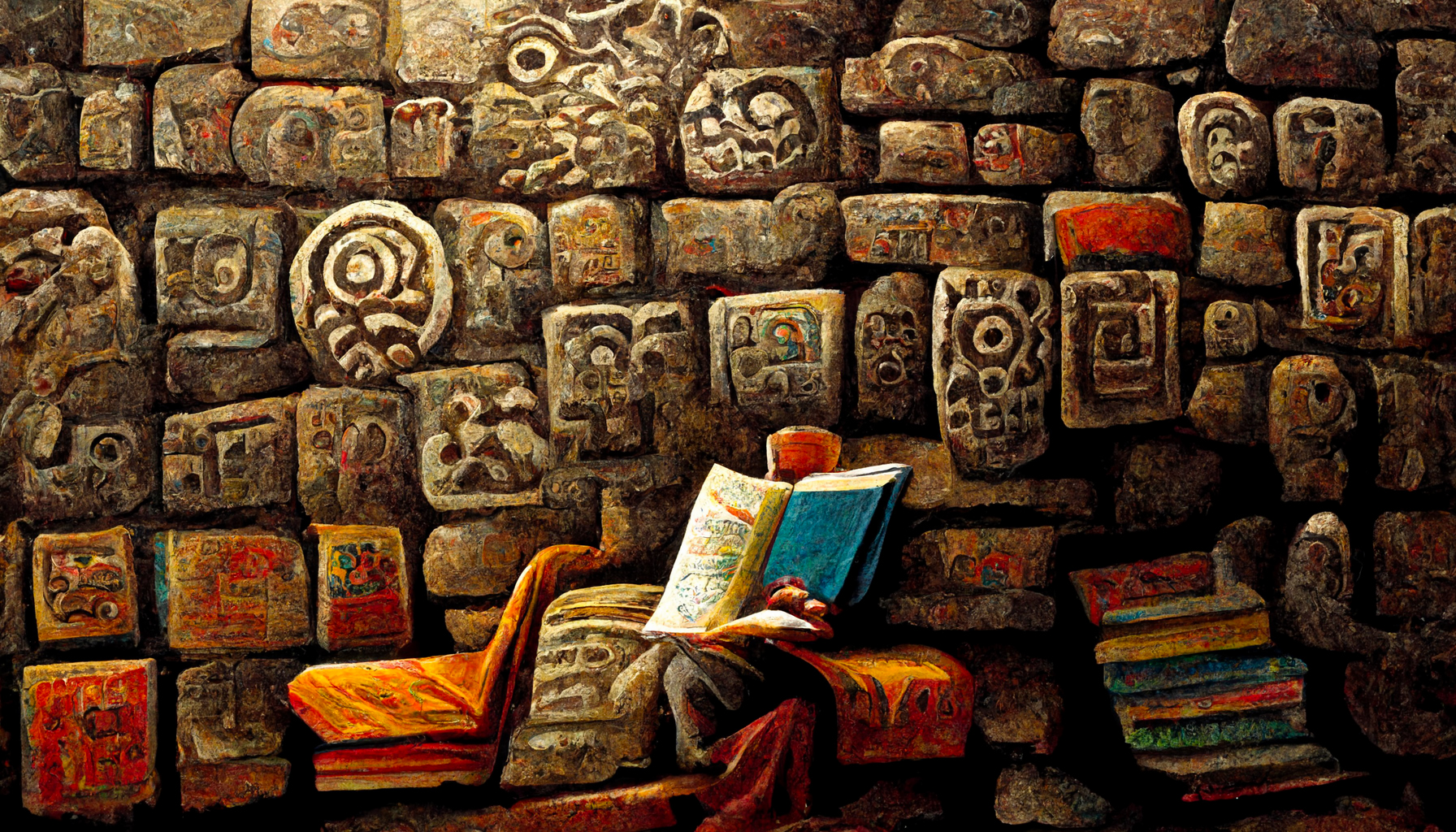Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les origines de l’humanité et son histoire. Avec Au Commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, David Graeber et David Wengrow nous emmènent dans un voyage à travers l’extraordinaire diversité des sociétés humaines.
On connaissait l’anthropologue David Graeber pour sa magistrale histoire de la dette1, ou pour son concept de « bullshit jobs », qu’il développe dans un ouvrage du même nom devenu best-seller2. Quand on apprend, quelques mois après avoir été attristé par sa mort, que l’anthropologue américain a écrit, en collaboration avec l’archéologue David Wengrow, un ouvrage revisitant l’histoire de l’humanité, on ne peut qu’être pressé de le découvrir.
Wengrow et Graeber partent d’un constat clair. L’ensemble des récits sur les origines de l’humanité sont emplis de postulats évolutionnistes qui les rendent faux. Ainsi, des sociétés égalitaires de chasseurs-cueilleurs abritaient les premiers Homo sapiens. L’invention de l’agriculture aurait permis l’accumulation de ressources entre les mains de quelques-uns. Avec elle seraient nées la propriété privée et l’inégalité. La concentration des êtres humains dans des villes auraient nécessité le développement de l’administration et une complexification des procédés de gouvernement. Cette lecture pose nos ancêtres comme prisonniers d’une histoire déjà écrite, le progrès technique les poussant inexorablement, au fil des siècles, vers notre propre modèle d’organisation sociale et politique. Or, les recherches archéologiques et anthropologiques du XXe et XXIe siècle, que n’avaient pas sous la main les philosophes ayant produits les premiers récits cohérents sur l’histoire de l’humanité comme Hobbes, Rousseau ou Turgot, nous permettent d’imaginer une toute autre histoire.
Les premières traces culturelles liées à Homo sapiens, les peintures dans les grottes et les sépultures datant de la période allant de -75 000 à -15 000 ans, ont donné deux types de discours jugés peu prudents par Wengrow et Graeber. Ou bien les hommes évoluaient en bandes parfaitement égalitaires. Ou bien l’existence de sépultures à l’allure, à priori, prestigieuse était interprétée comme la preuve de l’existence de l’inégalité dès le début de l’humanité. Ce qui est le plus probable, nous disent les auteurs, c’est que nos semblables aient expérimenté une infinie diversité d’organisations sociales, et ce depuis les débuts d’Homo sapiens. Il faut dire que ces êtres humains étaient absolument « comme nous », d’un point de vue biologique. Le même cerveau. Ils étaient donc capables de penser politiquement, de réfléchir à leur organisation sociale. L’anthropologie est une discipline qui a été témoin de l’inventivité humaine en cette matière. Des sociétés d’Amazonie avaient, par exemple, des gouvernants six mois dans l’année, pendant la période où la nourriture était plus rare et difficile à répartir, et étaient parfaitement égalitaires le reste du temps.
Au cours de ce voyage archéologique Graeber et Wengrow révèlent un certain nombre de mythes que nous nous racontons sur l’évolution de l’humanité. Je ne peux m’empêcher de vous citer quelques vérités contre-intuitives qui vous donneront peut-être envie de découvrir ce livre. La concentration d’humains dans des villes de plus en plus grandes n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’administrations. À l’inverse, des traces d’inventaires et de comptages administratifs rigoureux se retrouvent dans de très petites communautés. La politique, la hiérarchie sociale, le gouvernement, ne seraient donc pas une histoire de taille ou d’échelle. Les humains ne seraient pas prisonniers de leur nombre, de leur concentration en un espace donné, ou alors seulement partiellement. De la même manière, l’existence d’un appareil administratif ne signifie par nécessairement l’existence d’un souverain, d’un gouvernement très centralisé, et de classes sociales inégalitaires. Les auteurs tentent de montrer que les assemblées citoyennes de la Mésopotamie antique avaient, vers -3500 ans, d’importants pouvoirs dans des villes très égalitaires. Il existe également des cités antiques, comme celle de Teotihuacán au Mexique, dont les traces de hiérarchies sont fortes pour une période donnée, avant de s’estomper totalement, comme si elles avaient connu des épisodes révolutionnaires. Les temples gigantesques semblent ainsi avoir été incendiés, puis totalement délaissés, pendant que les habitations prenaient un caractère très uniforme.
Ce qu’on retiendra de ce voyage est l’importance de faire un travail de comparaison global de l’ensemble des recherches archéologiques sur les sociétés humaines. Cela nous apprend que l’histoire de l’humanité est infiniment plus riche qu’on ne le croit. Et cette richesse est notamment une richesse politique. Il est facile d’affirmer que tout nous a mené à la configuration sociale que nous vivons aujourd’hui. Mais c’est oublier tous les autres chemins qui ont pu être empruntés, les trajectoires qui se sont confrontées, les choix politiques qui ont été, sont, et seront faits. L’humain ne semble ainsi jamais pris au piège de ses configurations sociales. Il est capable de les penser, de les réinventer, de les fuir, de les renverser.