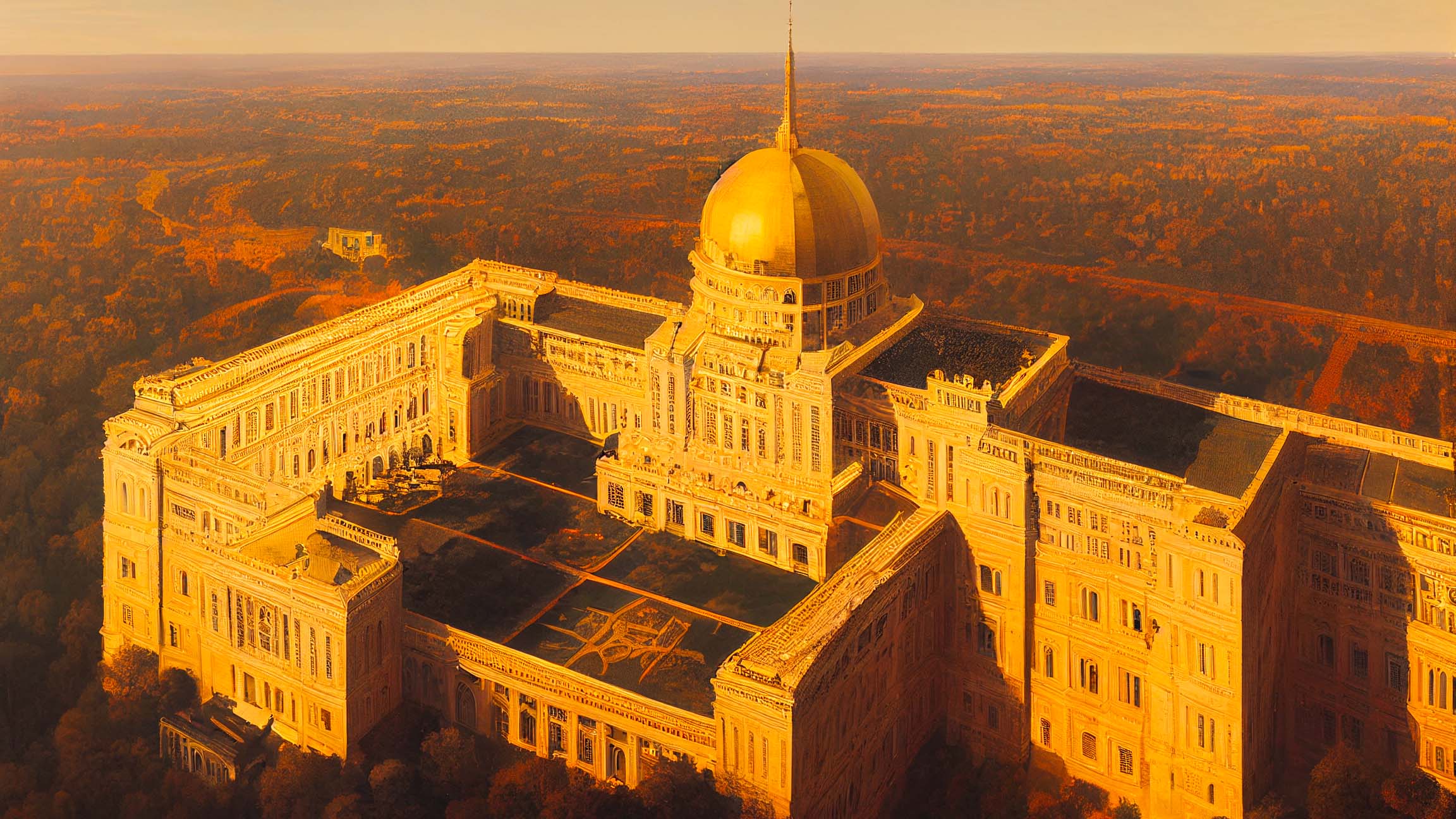L’État n’est pas toujours clairement différencié du gouvernement, de l’administration ou de la bureaucratie. Certains disent qu’il s’affaiblit, d’autres qu’il se renforce. Certains encore, se demandent à quoi il sert et qui il sert. Il s’agit ici de vous exposer une partie de ce que la science sociale a à dire sur l’État. Qu’est ce que l’État ?
L’État n’est pas un contrat
Revenons sur quelques conceptions de la construction de l’État que les sciences sociales ont pu écarter. La vision hobbesienne faisait de l’État une condition de la sécurité des hommes. Pour sortir d’un « état de nature » chaotique et dangereux, les êtres humains auraient choisi de mettre leur sécurité entre les mains d’une institution puissante, en échange du paiement d’un impôt. L’État, ou ce qu’il nomme « Léviathan », serait la réponse à l’insécurité.
Thomas Hobbes fait partie, tout comme Jean-Jacques Rousseau ou John Locke, de ce qu’on appelle les philosophes du « contrat social ». Bien que leurs pensées respectives soient radicalement différentes, elles postulent toutes qu’un groupe d’humains décide librement de laisser une part de sa liberté en échange d’avantages liés à la vie dans un État. Tous ces récits sont faux. L’« état de nature » de Hobbes ou les individus primitifs de Rousseau n’ont jamais existé. Le passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés étatiques n’a rien de mécanique et d’inéluctable. Nous avons affaire à des processus politiques. Ce qu’on appelle le « développement », et qui correspondrait à une mutation « naturelle » des sociétés humaines, n’existe pas. Des anthropologues ont pu observer, par exemple, des sociétés sans État dans lesquelles l’ordre et la sécurité étaient plus forts qu’en Occident. Nous allons voir que les mécanismes qui ont fait émerger des constructions étatiques n’ont rien à voir avec ce qu’on pourrait appeler un « contrat social », mais plutôt avec la guerre, la contrainte, la violence, la domination.
Une mafia qui a réussi ?
L’État est une autorité politique souveraine à laquelle est soumise un groupement humain sur un territoire donné. Nous pourrons revenir sur les problèmes posés par cette définition, notamment en terme de compréhension de ce qu’est la souveraineté, mais elle a l’avantage d’être assez générale pour débuter. En ce sens, l’État n’est pas fondamentalement différenciable d’un groupe armé, ou d’une « bande de soldats », aurait dit Friedrich Engels. L’historien et sociologue Charles Tilly explique par sa phrase, « l’État est une mafia qui a réussi », que le prélèvement forcé de l’impôt et le monopole de la violence constituent les traits fondamentaux de l’État1. C’est le fait qu’il ait réussi à faire accepter cet état des choses comme légitime, tout en éliminant totalement ses concurrents potentiels, qui le distingue d’une mafia. Un État est, en effet, un petit peu plus qu’une mafia.
La définition de Max Weber est celle qui est le plus reprise pour décrire l’État en science sociale. « Nous entendons par État une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime »2. Il faut bien comprendre que la légitimation d’un État est un processus long et violent, fait de guerres et de méthodes de domestication des populations. Ce n’est pas l’avènement d’un contrat venu de nulle part. On retient également de Weber son analyse de l’administration et de ses logiques propres, comme trait fondamental de l’État occidental. Jacques Lagroye ajoute trois autres dimensions pour décrire « l’État moderne ». La forte spécialisation des rôles politiques, l’apparition d’une bureaucratie ayant une certaine autonomie, ainsi que la différenciation de corps et d’institutions spécialisés3. Il faut toutefois être très prudent ici. Si les structures étatiques d’aujourd’hui combinent presque tout le temps une souveraineté absolue sur leur territoire et une administration spécialisée, l’association des deux n’a rien non plus de mécanique. Nous verrons un peu plus loin ce qu’implique la généralisation de cette forme étatique.
L’État dans le capitalisme, l’État capitaliste
Dans la pensée marxiste, l’État ne peut être défini indépendamment du régime économique de la société dans laquelle il se situe. L’approche est généralement plus centrée sur les institutions qui composent, mais aussi contraignent et encadrent l’État et le gouvernement de la société. Dans le régime de production capitaliste, caractérisé par la domination d’une classe qui possède les moyens de production sur une classe qui ne possède que sa force de travail, l’État est capitaliste. Il l’est en fait de deux façons. Il l’est d’abord par des mécanismes de sélection qui offrent une majorité des postes de pouvoir à des représentants de la classe bourgeoise. Il l’est ensuite, et de manière beaucoup plus fondamentale, par ses structures qui ont tendance à protéger les intérêts de la bourgeoisie quel que soit le pouvoir en place.
Précisons qu’il serait faux de dire que les institutions de l’État ont été élaborées dans l’unique but de protéger les intérêts de la classe dominante. On a vu que les processus de construction étatiques sont complexes, multiples et sans réel pilote. Il serait plus juste, en revanche, de dire que les groupes sociaux qui ont eu des positions économiques dominantes dans la société ont été particulièrement actifs dans les constructions institutionnelles étatiques. Les représentations et intérêts de classe de la bourgeoisie se retrouvent ainsi fortement ancrées dans les institutions. C’est le cas notamment dans les règles juridiques qui sacralisent la propriété privée. De même, les corps étatiques plus ou moins autonomes comme l’armée, la police ou l’éducation transmettent des manières de faire et de voir les choses qui tendent à préserver l’ordre économique et social.
Un autre exemple intéressant est l’isoloir. Ce dernier est devenu l’un des éléments clés du dispositif de vote dans les États modernes. Or, il va de pair avec un discours prônant un vote individuel en fonction des ses opinions personnelles, et non un vote collectif en fonction de ses intérêts de classe. Il tend donc à masquer les antagonismes de la société et faire perdurer les modes de domination qui la caractérisent. On pourrait aussi évoquer des éléments plus récents comme l’indépendance des banques centrales qui tend à retirer les questions monétaires des débats politiques, ou l’endettement de l’État sur les marchés financiers qui limite ses marges de manœuvre budgétaires. On comprend ainsi pourquoi Engels affirmait que le pouvoir de l’argent n’est pas plus en danger dans une république démocratique que dans un régime monarchique ou dictatorial.
Nicos Poulantzas est peut-être à l’origine de la théorie la plus fine de l’État capitaliste dans la tradition marxiste. On la retrouve dans son ouvrage L’État, le pouvoir, le socialisme4, qu’il publie à la fin des années 1970. Il développe notamment l’idée selon laquelle l’État dispose d’une « autonomie relative ». Il n’est pas un simple instrument de la classe dominante, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, la bourgeoisie est plurielle, c’est-à-dire que ses intérêts sont en fait divisés. Le capital financier peut rentrer en contradiction avec le capital industriel, par exemple. De plus, les classes dominantes ne maîtrisent pas nécessairement la défense de leurs propres intérêts. Elles se trompent régulièrement, privilégient parfois des intérêts de court terme aux intérêts de long terme, peuvent déclencher des crises. L’État est « la condensation matérielle d’un rapport de force entre les classes et les fractions de classe », nous dit Poulantzas. Il naît donc des relations conflictuelles entre les classes. Il est un lieu de lutte, une lutte politique dû aux contradictions d’intérêts. Son autonomie est plus ou moins marquée en fonction des périodes. Il faudrait par exemple réfléchir aujourd’hui aux conséquences de la position de force du capital financier sur cette autonomie.
Déconstruire l’État pour mieux le comprendre
L’État n’est pas une entité indivisible qui agit toujours dans une seule direction. Les institutions et les acteurs, qui agissent au sein de l’État et au nom de l’État, le font en partie selon des logiques qui leurs sont propres et qui rentrent souvent en contradiction les unes avec les autres. Dans le dernier livre de David Wengrow et David Graeber5, que nous vous avions présenté dans l’un de nos précédents articles, les auteurs citaient cette jolie phrase du sociologue Philip Abrams : « L’État n’est pas la réalité tapie derrière le masque de l’exercice de la politique : il est le masque lui-même. Il est ce qui nous empêche de voir l’exercice de la politique pour ce qu’il est. » Les relations très concrètes de pouvoir et de domination dans la société sont la plupart du temps difficilement compréhensibles avec la seule notion d’État. Il faut savoir s’en défaire pour comprendre qui agit en son sein, de quelle manière et au nom de quels intérêts. La police, par exemple, n’est pas qu’une main de l’État. Elle agit par elle-même, elle exerce du pouvoir. Le policier n’est pas qu’un agent de l’État, il exerce aussi du pouvoir. Chaque agent et chaque institution possède une autonomie relative.
Je terminerai par une réflexion formulée par Wengrow et Graeber dans leur ouvrage cité plus haut. En explorant une grande diversité de sociétés depuis la préhistoire, l’archéologue et l’anthropologue se sont rendus compte que dans une grande quantité de cas, la possibilité de fuir une configuration sociale donnée pouvait apparaître comme une liberté fondamentale. De nombreuses sociétés se seraient ainsi construites par opposition les unes aux autres. Ceux qui étaient opprimés, ou tout simplement mécontents dans un ordre social donné pouvaient le quitter et en reconstruire un, dans la plaine d’à côté, sur des bases totalement opposées. À l’inverse, ce qui caractériserait peut-être le mieux la forme actuelle de l’État serait l’impossibilité de la fuir. Pour ceux qui subissent les injustices que cette configuration sociale permet, il n’est d’autre horizon que de la subir, ou de la changer.
- Charles Tilly, Cities and the Rise of States in Europe, 1995 [↩]
- Max Weber, Économie et Société, 1921 [↩]
- Jacques Lagroye, Sociologie Politique, 2006 [↩]
- Nicos Poulantzas, L’Etat, le pouvoir, le socialisme, PUF, 1978 [↩]
- David Wengrow, David Graeber, Au commencement était, une nouvelle histoire de l’humanité, Les Liens qui libèrent, 2021 [↩]