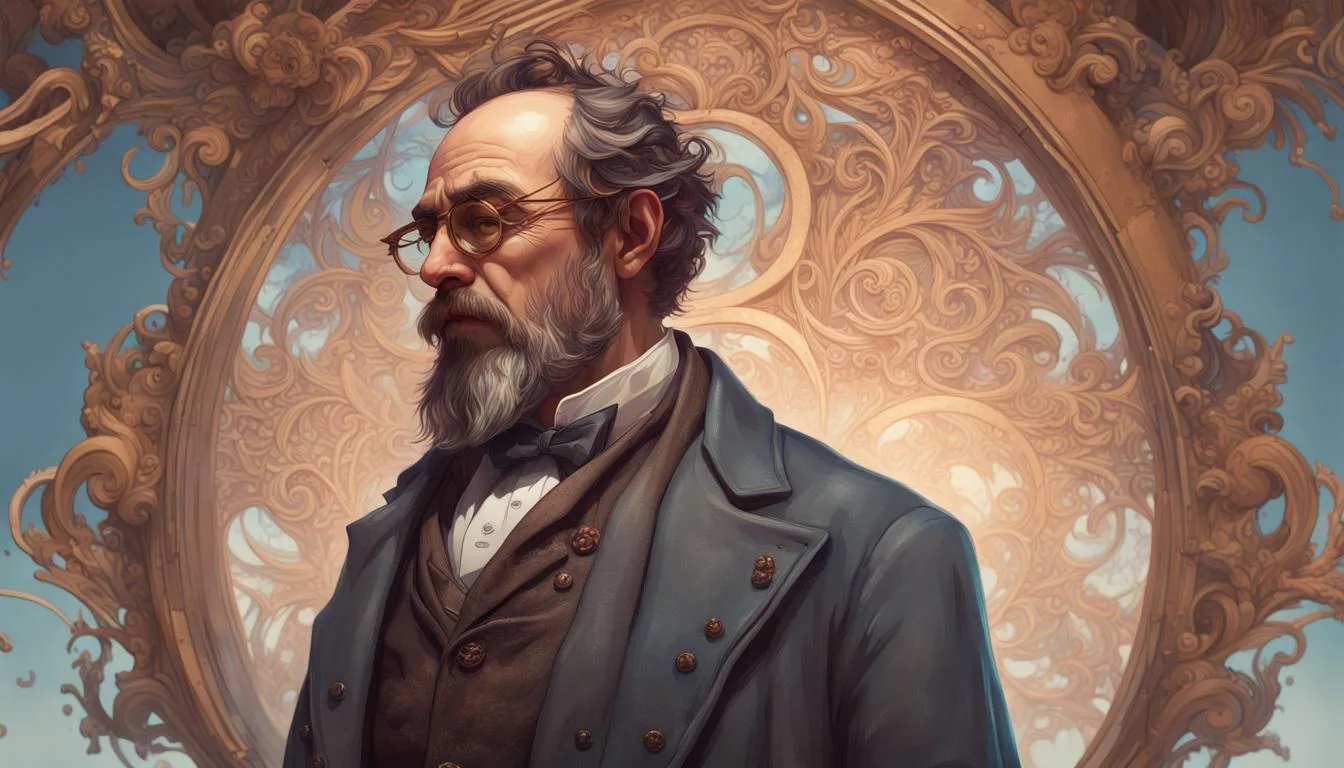2024 est là. Anakalypto, ça continue, mais comment ? On a écrit en 2023, on a observé surtout. Le temps politique et, par extension, le temps médiatique sont difficiles à appréhender. Ils ont leur loi. Les faits et les actions se succèdent et ne durent qu’un instant. Ils sont oubliés, perdus dans le flot ininterrompu d’informations, avant d’être compris. L’agenda gouvernemental est bien souvent le seul maître du temps politique. Alors, on a écrit au moment de la lutte sociale contre la réforme des retraites. On a tenté de comprendre les logiques de l’opération policière de grande ampleur à Mayotte. On a choisit nos sujets, parlé quand nous avions à dire, mais il est vrai qu’on s’est peut extrait de la dictature du temps court. Ainsi se forme une résolution (on verra si l’on s’y tient). Porter notre regard politique sur la banalité de notre quotidien, sur les tâches que l’on remplit sans protester, sur les films que l’on regarde sans penser, s’étonner de ce qui fonctionne et nous fait fonctionner. A la manière d’un naturaliste, notre seule boussole sera la recherche de ce qui est juste.
Les Rougon-Macquart sont une série de vingt ouvrages écrits par Emile Zola entre 1870 et 1893. Le sous-titre, « Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire » nous en révèle l’ambition. Il s’agit d’une entreprise que l’auteur qualifie lui-même de « scientifique ». « Je soumets les hommes et les femmes aux choses » dit Zola1. Tout simplement. Des hommes et des femmes, donc. Principalement une famille et ses trois générations, dispersée dans toute la France et dans des milieux sociaux variés de la société du XIXe siècle. Le poids de la famille, avec ses lois d’hérédité et d’innéité (l’absence de traits héréditaire), se confond chez Zola avec une détermination sanguine, inscrite dans la nature propre des individus et qui s’exprimerait de manière implacable. Cela peut faire sourire au XXIe siècle, avec les acquis sociologiques dont nous disposons. Pourtant, le postulat assez faux que propose Zola aboutit à des personnages complexes, qui ont toute leur cohérence. Certes, les traits sont souvent accentués, mais la cupidité, l’avidité, l’avarice, même dans leurs formes les plus extrêmes, existent bel et bien. Elles peuvent même apparaître comme des traits psychologiques fondamentaux du XIXe siècle, qui est l’époque de construction et de consolidation d’un capitalisme débridé.
Ce qui est passionnant chez Zola est la confrontation de ces individualités aux « choses ». Les choses, c’est le milieu social, le contexte politique, les traditions qui se reproduisent, les phénomènes qui émergent du collectif et que l’individu ne maitrise pas. Durkheim, Émile lui aussi, père fondateur de la sociologie française, parlera de « faits sociaux ». On n’y est pas encore tout-à-fait. De la ruralité profonde dans La Terre jusqu’au monde politique des petits salons parisien dans Son excellence Eugène Rougon, en passant par le monde ouvrier dans Germinal, ou encore celui de la finance en construction dans La Curée, les descriptions sont précises. Tel un sociologue, Zola s’intéresse aux actions qui durent dans le temps, aux routines, aux usages des milieux qu’il étudie. Il s’efforce de ne pas formuler des jugements moraux ou politiques, même si son œuvre en contient nécessairement. Peut-on réellement décrire objectivement la vie des paysans de la Beauce lorsqu’on est un écrivain parisien ? C’est le rêve inatteignable de la sociologie que d’y parvenir. Et c’est une autre histoire. En attendant, contentons nous des leçons de feu Émile Zola. Tenons nous à l’écart des la grande histoire. Décrivons celle qui se déroule sous nos yeux sans faire de bruit.
- Émile Zola, Différences entre Balzac et moi, 1869 [↩]